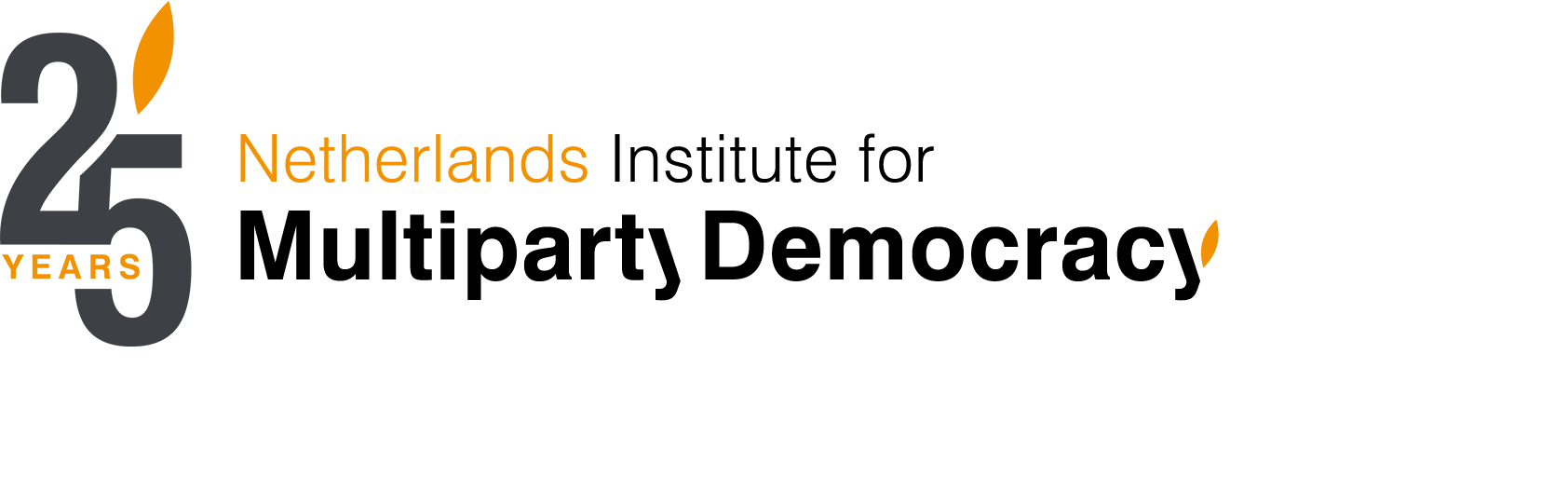#UN75 : Le changement que nous voulons voir ? Un nouveau souffle pour le Mali

Pour célébrer ses 75th anniversaire, les Nations unies organisent un dialogue mondial, demandant aux gens du monde entier de réfléchir à l'avenir qu'ils souhaitent.
Pour le NIMD, la réponse est claire : l'avenir que nous voulons est une société plus inclusive, où les démocraties peuvent prospérer et où les acteurs politiques peuvent placer les intérêts publics, et non l'aversion pour la crise, en tête de l'agenda.
Dans le cadre de notre réflexion, le directeur régional du NIMD pour le Sahel Mirjam Tjassing examine comment nous pouvons contribuer à une démocratie meilleure et plus résistante au Mali.
Sur les 18th En août 2020, un groupe de jeunes officiers a pris le pouvoir au Mali. Sous la bannière du Comité national pour le salut du peuple (CNSP), leur démarche s'est soldée par la dissolution du parlement par le président, qui a lui-même démissionné. Depuis lors, des consultations nationales ont abouti à l'élaboration d'une Charte de la transition et d'une Feuille de route. La mise en place des organes de transition est en cours.
Après le coup d'État, la CEDEAO a immédiatement appelé à un retour à l'ordre constitutionnel, à une courte transition sous une direction civile et à des élections rapides. Cela semble très raisonnable, jusqu'à ce que l'on prenne en considération le fait que des dizaines de milliers de Maliens manifestaient dans les rues depuis plusieurs semaines, exigeant le départ de l'ancien président IBK, et que le coup d'État a été accueilli au Mali avec un certain soulagement. Il est intéressant de noter qu'après le coup d'État, il n'y a pas eu de présence militaire dans les rues, pas de pillage ni de désordre ; les Maliens ont repris leurs activités comme si de rien n'était.
L'embargo de la CEDEAO imposé au Mali n'a pas du tout été apprécié par la population. On a eu l'impression que des intérêts étrangers avaient pesé sur cette décision plutôt qu'une réelle prise en compte de la situation au Mali. Cette position était soutenue par les organisations de la société civile des pays voisins. Aujourd'hui, les sanctions ont été levées, mais les conséquences du bras de fer entre la CEDEAO et le CNSP risquent de se faire sentir au-delà des frontières du Mali. C'est l'heure de vérité : quel est le sérieux de la CEDEAO en matière de démocratie ?
Échec collectif
Il est évident que dans une démocratie qui fonctionne, il n'y a pas de place pour les prises de pouvoir militaires. Mais quelle était l'efficacité de la démocratie malienne au départ ? Le coup d'État au Mali est un échec collectif de la classe politique malienne et de la communauté internationale à sauvegarder les principes démocratiques.
Cet échec a permis de réduire la politique au Mali à un ensemble de stratégies visant à redistribuer le pouvoir et la richesse et à atténuer la "capacité de nuisance" des autres membres de la classe politique. La politique joue rarement un rôle dans l'orientation des politiques ou la défense du bien commun. Par conséquent, se précipiter vers les élections, comme si cela allait magiquement changer la situation, n'est pas seulement inutile, c'est dangereux. C'est ce qui a été fait en 2012, et regardez où cela a mené le Mali. Nous devrions donc nous concentrer moins sur les sanctions que sur la véritable question : comment s'assurer qu'il n'y aura plus jamais de coup d'État ?
La démocratie, c'est plus que des élections
Les élections sont essentielles à la démocratie, mais elles ne la définissent pas. Pour que les élections jouent leur rôle, il faut qu'elles soient de véritables instruments de représentation. Or, ces dernières années, l'insécurité, les graves soupçons de fraude et la manipulation des résultats ont sérieusement entamé la crédibilité des élections aux yeux de l'opinion publique malienne.
Mais il y a autre chose, dont on parle moins, à savoir que les élections impliquent des programmes politiques. Sur la base de l'étude du NIMD sur le coût de la politique, nous savons que l'argent a pris la place des programmes politiques et a eu un effet paralysant sur la représentation et la responsabilité. Or, sans représentation, il n'y a pas de véritable démocratie.
En bref, compter sur l'électorat pour élire des représentants crédibles en dépit de la fraude électorale et de l'achat de votes à grande échelle semble être une stratégie inefficace.

Il est important de se rappeler que la démocratie n'est pas une fin en soi, mais un moyen de parvenir à la stabilité et à la paix. Il s'agit de placer le développement et les services de base au cœur de la gouvernance, plutôt que de répondre aux besoins d'une élite politique et économique. Aujourd'hui, on s'accorde de plus en plus à dire que l'extrémisme violent, la violence intercommunautaire et les migrations sont tous la conséquence directe d'une mauvaise gouvernance.
Définir l'agenda des réformes démocratiques
Qu'il s'agisse de coups d'État ou de soulèvements populaires, la question est de savoir comment mettre fin à la gouvernance par perturbation. Que peut-on faire pour rendre la démocratie efficace, afin qu'elle réponde réellement aux besoins de la population et qu'elle absorbe les frustrations des électeurs ? La focalisation de la CEDEAO sur la question de savoir qui va diriger la transition et pour combien de temps détourne l'attention de la vraie question, à savoir ce qui est nécessaire pour aider le Mali sur la voie d'une démocratie efficace.
Mettons le Protocole additionnel de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance à bon escient. Ne pas soutenir des chefs d'État dont la légitimité est remise en cause. Pas pour jeter l'opprobre et sanctionner une population qui souffre déjà d'une crise multidimensionnelle. Utilisons-le plutôt pour orienter les réformes en vue d'élections libres et équitables et d'un meilleur équilibre institutionnel que les Maliens eux-mêmes proposent dans la feuille de route de la transition.

Et comme nous sommes en pleine crise de la représentation, ne nous focalisons pas trop sur les individus qui s'assoient à la table, mais cherchons des idées. Écoutons ce que les Maliens ont à dire. Les technologies modernes offrent toutes sortes de possibilités d'expression. En ligne, les Maliens s'expriment à travers le hashtag #MaTransition. Le pays a maintenant la possibilité d'élaborer de manière participative des orientations politiques et de réforme pour la période post-électorale.
Tous les regards se tournent vers la CEDEAO
N'oublions pas que le monde n'a jamais été aussi connecté, que l'information n'a jamais été aussi facile d'accès. Les citoyens d'autres pays d'Afrique de l'Ouest regardent ce qui se passe au Mali. Nous ne pouvons pas continuer à citer de manière sélective les "principes démocratiques et républicains" pour défendre un statu quo alors que la perception est que la démocratie n'est pas effective et que les valeurs républicaines ne sont pas respectées. Cela ne servira qu'à discréditer la communauté internationale, ses conventions ET la démocratie.
Alors, au lieu d'essayer de maintenir désespérément en place un château de cartes qui s'écroule, aidons le Mali à se doter de nouvelles fondations et à prendre un nouvel élan.