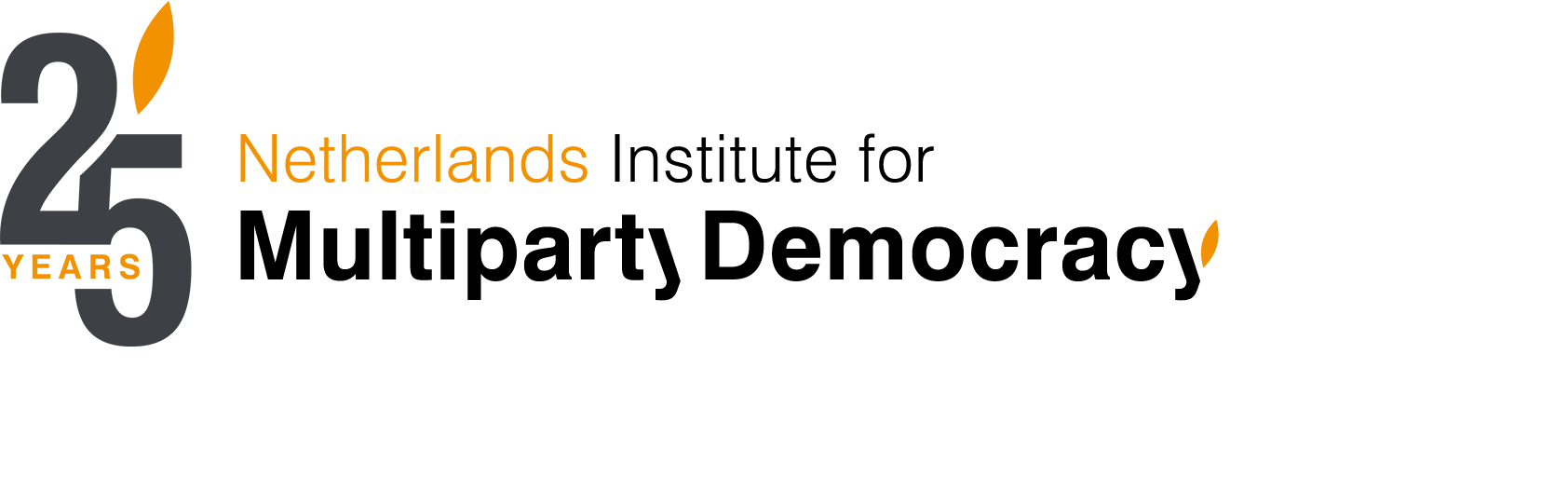Les partis politiques et la montée du populisme
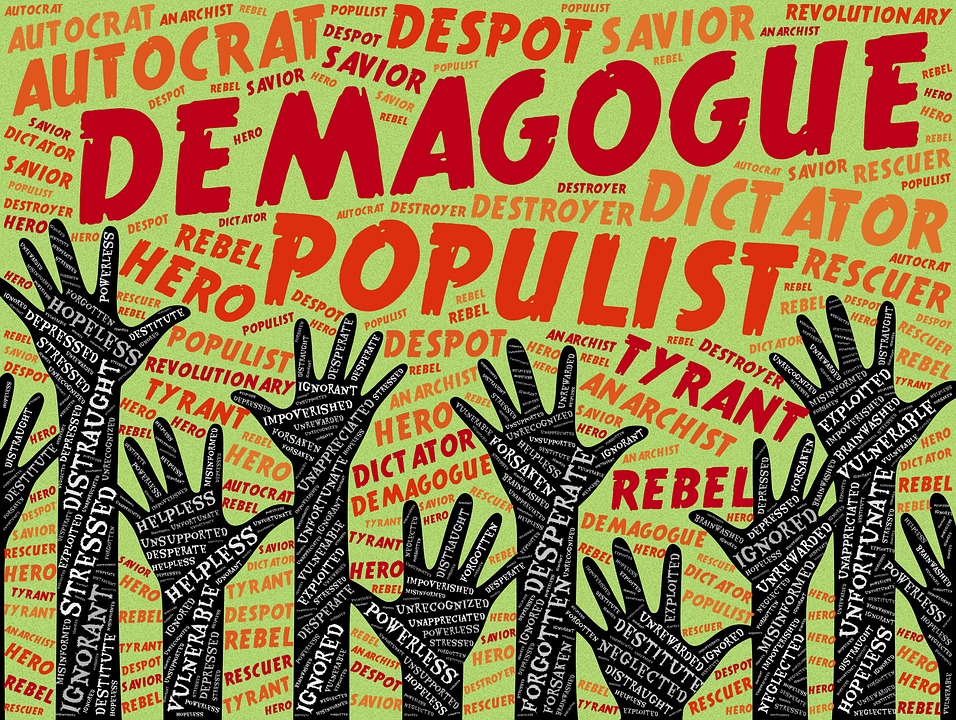
Inspirée par notre conférence sur La représentation à l'ère du populisme - co-organisé par le NIMD, International IDEA, OSCE/BIDDH, REPRESENTANT et DCE - Dalila Brosto, conseillère en connaissances du NIMD, partage ses propres réflexions sur le rôle des partis politiques dans la montée du populisme et sur la manière dont ces partis peuvent regagner le soutien des citoyens.

Le populisme est devenu une force politique de plus en plus puissante ces dernières années : plusieurs pays européens, dont la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège et la Suisse, ont des partis de droite au pouvoir et les populistes de droite tels que l'UKIP britannique, le Front national français et l'Alternative für Deutschland allemande jouissent d'une popularité record. Comment expliquer cette situation ? Des facteurs externes sont-ils à blâmer, ou les partis politiques traditionnels sont-ils ceux qui sont incapables de faire face au mécontentement des masses ? Les partis politiques ont-ils échoué ?
Avant d'aborder la question du populisme, il est important d'en préciser la définition. Le populisme est une "idéologie mince", ce qui signifie qu'il peut avoir des partisans à gauche et à droite de l'échiquier politique et même créer ses propres hybrides, comme le Mouvement 5 étoiles (M5S) en Italie. Les politologues soulignent que le populisme prétend représenter un peuple moralement unifié, trahi par les élites, et donc la majorité silencieuse mais en colère. Les populistes excellent dans l'art de communiquer le mécontentement des électeurs ordinaires, en s'appuyant souvent sur leur rage à l'égard d'un establishment politique technocratique qui ne peut pas affronter les questions politiques émotionnelles en public.
La poussée populiste est, du moins en partie, une réponse aux échecs politiques apparents des partis établis à relever les plus grands défis de leur société - en Europe, principalement la migration et la crise persistante de l'euro - ainsi qu'une réaction à une grande coalition perçue entre le centre-gauche et le centre-droit. Les principaux partis européens se sont rapprochés de plus en plus du centre idéologique : de nombreux partis de gauche ont dépriorisé l'idéologie et adopté un "pragmatisme post-partisan", tandis que la droite s'est orientée vers un programme plus progressiste, principalement dans le domaine socioculturel.

En raison de la fragmentation des sociétés et de la polarisation des politiques, il est peu probable que la montée du populisme s'inverse de sitôt. Se lamenter sur les électeurs aliénés ne doit pas être la solution, pas plus que diaboliser les électeurs populistes.
Les effets de la mondialisation, notamment les mutations industrielles rapides, l'immigration de masse, l'évolution des valeurs sociales et le déclin du sentiment d'appartenance à une communauté sont des questions qui doivent être abordées par les partis politiques. Ce dont les partis ont besoin, c'est d'une alternative cohérente aux politiques économiques qui ont trop souvent contribué à creuser les écarts de revenus sur le continent. À mon avis, le moyen le plus efficace de regagner le soutien des citoyens est d'élaborer des politiques concrètes qui répondent directement à leurs inquiétudes et à leurs angoisses.
Les partis politiques européens doivent donc redécouvrir les vertus de l'hétérogénéité idéologique : au lieu de faire taire les voix dissidentes de l'intérieur, les structures des partis politiques doivent rouvrir le spectre aux opinions divergentes, dissidentes et controversées. En accueillant les opinions divergentes, les électeurs seront en mesure de s'identifier à des récits différents, redécouvrant ainsi leur engagement au niveau local et régional.