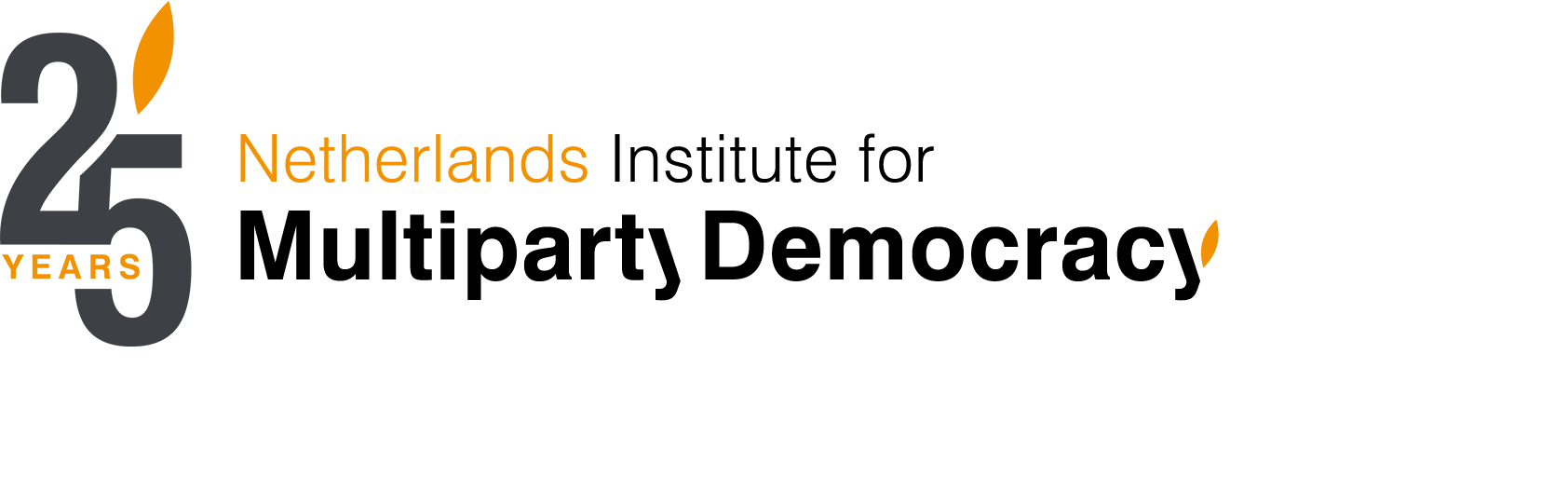Mozambique : Le dialogue au service de la lutte contre le changement climatique

Le récent sommet COP26 à Glasgow a suscité un débat sur le rôle de la démocratie dans la lutte contre le changement climatique. Ici, Hermenegildo MulhovoDirecteur exécutif de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) Institut pour la démocratie multipartite (IMD) et partenaire du NIMD au Mozambique, affirme que la démocratie est le seul système capable de relever le défi.
À bien des égards, la planète Terre est le projet démocratique par excellence. Chaque personne qui y vit est concernée par son avenir. Malgré les efforts déployés pour morceler ses terres, imposer des frontières à ses mers et diviser son atmosphère en espaces aériens, il ne fait aucun doute que l'air que nous respirons et la nature qui nous entoure sont là pour le bénéfice de tous.
Pourtant, lorsque les dirigeants du monde se réunissent lors de sommets tels que le récente COP26 à GlasgowLe débat peut sembler lointain et il est difficile de sentir que l'on a son mot à dire dans les discussions. Cette situation peut être particulièrement frustrante pour les personnes confrontées aux effets les plus graves du changement climatique, qui vivent souvent dans des pays plus petits ou moins développés, ce qui amplifie ce sentiment d'impuissance.

Ce sentiment d'un immense défi mondial nécessitant des mesures rapides et radicales a également amené certains groupes de la société à se demander si les procédures démocratiques devaient s'appliquer. Selon eux, l'ampleur et l'urgence de la situation justifient peut-être la suspension de certains processus démocratiques normaux.
Mais je crois que le contraire est vrai : la démocratie est vitale dans la lutte contre le changement climatique. Si les gens n'ont pas le sentiment d'avoir participé au processus et d'être concernés par les solutions, il n'y a que peu d'espoir de réussite.
Au Mozambique, nous avons eu il y a quelques années un exemple frappant de l'impact direct que le changement climatique peut avoir sur la démocratie. En mars 2019, le cyclone Idai a dévasté des pans entiers du pays. Il s'agit du cyclone le plus puissant enregistré en Afrique australe, et le Mozambique est désormais reconnu comme l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. un des pays les plus touchés par des phénomènes météorologiques extrêmes liés au réchauffement climatique.

Sept mois après le cyclone Idai, nous avons organisé des élections générales. Le déplacement massif de dizaines de milliers de personnes avait désorganisé l'inscription sur les listes électorales. Les écoles qui devaient servir de bureaux de vote ont été détruites ou utilisées pour loger les personnes déplacées. Ce sentiment de chaos a permis à certains acteurs politiques de manipuler la crise, avec des rapports sur le trucage des votes et des accusations de corruption et de détournement de l'aide.
Les élections ont eu lieu, mais de nombreuses personnes ont estimé que les événements qui ont précédé le scrutin ont entaché leur légitimité, et ce sentiment négatif jette une ombre sur notre démocratie aujourd'hui.
Inclure tout le monde dans le débat
Depuis lors, notre Institut pour la démocratie multipartite, en partenariat avec le NIMD, a fait du changement climatique et de l'environnement une priorité absolue de son travail.
Nous nous sommes toujours efforcés de promouvoir le dialogue sur les normes dans les industries extractives, mais alors que dans le passé nous nous concentrions sur la gouvernance et la transparence, aujourd'hui nous nous intéressons également à l'impact sur l'environnement.

Le 22 novembre, nous avons réuni des représentants de la société civile, du gouvernement, des partis politiques et de la communauté internationale à l'occasion d'une conférence de presse. une conférence de deux jours sur les industries extractives. Des représentants des milieux politiques et de la société civile se sont réunis pour débattre de l'équilibre entre l'exploitation des ressources et la préservation de l'environnement.
Parmi les thèmes abordés lors de la conférence figuraient le rôle du genre dans les industries extractives et l'importance de veiller à ce que les bénéfices de l'exploitation des ressources soient partagés équitablement.
"La démocratie crée l'espace nécessaire à l'émergence d'un consensus, ce qui permet de prendre des décisions significatives ayant un impact à long terme.

Cette inclusion est essentielle : si les gens se sentent exclus du dialogue sur le changement climatique, ils ne se sentiront pas concernés par les solutions.
Par exemple, il existe au Mozambique de vieilles pratiques agricoles et de pêche dont on sait aujourd'hui qu'elles sont néfastes pour l'environnement. Pourtant, certaines familles continuent de les pratiquer, car leur subsistance en dépend. Le fait d'intervenir et de dire simplement aux gens d'arrêter n'aurait que peu d'impact. Chaque fois que vous imposez quelque chose, personne n'en est propriétaire.
En garantissant la participation des groupes de la société civile aux discussions de haut niveau, nous nous assurons que la voix de chacun est entendue.
Il doit s'agir d'une discussion d'égal à égal au cours de laquelle nous trouverons un terrain d'entente sur la manière dont nous pouvons protéger la nature ensemble afin de garantir nos moyens de subsistance à l'avenir.
La démocratie crée l'espace nécessaire à la réalisation de ce consensus, ce qui permet de prendre des décisions significatives ayant un impact à long terme.
Il est essentiel de créer des plates-formes neutres pour ces interactions entre les citoyens, les organisations de la société civile et le gouvernement. Dans le passé, on avait l'impression qu'il y avait un fossé, avec les décideurs politiques d'un côté et la société civile de l'autre, et toutes les interactions étaient souvent conflictuelles. Cela ne permet pas d'obtenir des résultats durables.

Nous devons donc faciliter l'accès entre la société civile et les décideurs dans un cadre non conflictuel, afin qu'ils puissent s'influencer mutuellement et travailler ensemble. Tous les partis politiques doivent également prendre part à ce dialogue, en acceptant de collaborer au-delà des clivages politiques pour le plus grand bien de tous.
Cela se répercute également au niveau mondial. Bon nombre des dirigeants antidémocratiques que nous voyons aujourd'hui dans le monde prônent des politiques nationalistes et repliées sur elles-mêmes. Or, nous avons besoin d'une coopération mondiale et d'un multilatéralisme pour relever les immenses défis auxquels nous sommes confrontés.
Saisissons donc ce moment et réengageons-nous en faveur des valeurs de l'inclusion et de la démocratie. Il est temps de faire preuve d'audace et de courage, de défendre et de promouvoir le seul système qui nous guidera tous vers un avenir meilleur.