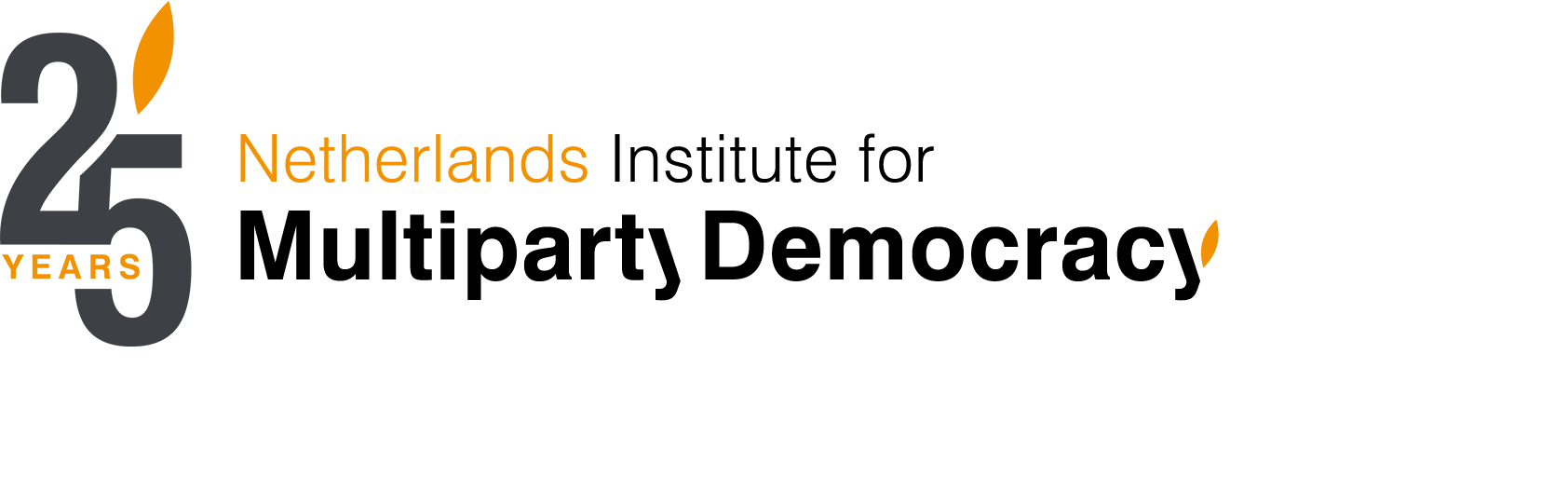La politique moderne est-elle si moderne que cela ?

Thijs Berman, directeur exécutif du NIMD.
Au cours du siècle dernier, nous avons assisté à plusieurs vagues de démocratisation. Les deux guerres mondiales et l'ère coloniale ont pris fin. Nous avons également assisté à la chute des dictateurs du sud de l'Europe, Franco et Salazar, ainsi qu'à la fin de la junte militaire grecque.
La démocratie semblait conquérir le monde, inexorablement. Nous avons assisté à la chute de l'URSS, à la fin de Videla et de Pinochet en Amérique latine, et la démocratie a également progressé dans plusieurs régions d'Afrique. L'espoir d'un avenir démocratique était grand au tournant du siècle, et l'ère de l'information qui s'annonçait semblait être une nouvelle chance de se débarrasser des injustices du passé.
Malheureusement, le progrès n'a pas été irréversible. Nous sommes coincés dans les mêmes schémas que ceux que nous avons connus par le passé. La société reste désespérément inégale. Les crises financières, les conflits désastreux et la corruption ouverte ne sont que quelques-uns des nombreux signes qui montrent que nos vies sont encore fortement soumises aux injustices nationales et internationales - et il semble que nous ne puissions pas faire grand-chose, individuellement, pour y résister.
Cependant, les électeurs disposent également de plus d'informations que jamais et utilisent les nouveaux médias pour s'organiser et se faire entendre. Une pression ascendante s'exerce et le public exige d'être respecté.
Les mêmes problèmes, mais un contexte différent
Nous avions espéré être plus libres que jamais avec l'avènement de l'internet et des communications modernes. Nous nous sommes soudain retrouvés en mesure de communiquer facilement avec nos partenaires du monde entier et nous avons pu éclairer d'une lumière transparente les aspects opaques de la politique mondiale.
Parallèlement, l'ère de l'internet a donné lieu à un paradoxe : la technologie moderne a donné aux citoyens plus d'autonomie et de connaissances que jamais auparavant, mais les laisse moins maîtres de leur vie, noyés dans une mer d'informations et de désinformations souvent contradictoires.
Un autre paradoxe est qu'avec leur autonomie accrue, les électeurs sont de plus en plus réticents à déléguer une partie de l'autorité sur leur vie aux hommes politiques. En même temps, nous voulons que ces mêmes politiciens nous guident dans ce monde moderne complexe. Les mêmes électeurs qui disent "laissez-moi faire ce que j'ai à faire" demandent également à être guidés par un sauveur capable de "réparer" la société.
C'est l'une des raisons pour lesquelles la relation entre les électeurs et leurs dirigeants politiques est si tendue aujourd'hui.
Mais il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Cette recherche désespérée d'un sauveur peut parfois se traduire par l'appel aux hommes forts du passé, marchant dans l'histoire à grands pas dans des bottes ensanglantées.
Pourquoi les anciennes méthodes ne fonctionnent pas
La clé de la guérison d'une partie du paradoxe est le dialogue. Si nous voulons vraiment garantir une gouvernance démocratique pacifique et éliminer une partie de la tension inhérente entre les électeurs et les hommes politiques, nous devons changer la façon dont les citoyens et les dirigeants interagissent.
Mais de nombreux hommes politiques s'en sont tenus à la "stratégie classique" pour gagner la confiance : éviter d'aborder les incertitudes, nier la faillibilité et continuer à vendre un rêve. Créez une image forte, laissez entendre que vous avez les réponses et attaquez vos adversaires en les qualifiant de faibles et d'incompétents. Protégez votre noyau dur de votes et récupérez suffisamment de groupes flottants pour rester au pouvoir.
Sans surprise, cette stratégie engendre infailliblement la déception et, en fin de compte, elle sape même les institutions de la démocratie.
Quelle est la solution pour les partis et les hommes politiques ?
Selon moi, et sur la base de mon expérience, une option plus viable que cette stratégie consiste à établir une relation différente avec les électeurs, en plaçant le respect au centre des préoccupations.
Respecter le désir d'autonomie et le désir de vision, et engager un dialogue constant avec les électeurs. Oubliez les schémas préconçus et, au contraire, faites participer les électeurs à la recherche de solutions. Soyez ouvert aux dilemmes et aux difficultés, et montrez votre vision avec ambition et résilience. L'électeur moderne informé ne va pas se contenter de phrases toutes faites et de belles paroles sur la démocratie, tout en étant exclu du processus politique au sens large.
Ils veulent, à juste titre d'ailleurs, être consultés.
Le défi pour notre organisation
Si les partis veulent adopter cette approche plus inclusive, ils doivent abandonner la vieille stratégie consistant à vendre des slogans éculés. Ils devront adopter une attitude différente. Et leurs candidats devront croire réellement aux valeurs de la démocratie et considérer les citoyens comme des égaux politiques.
J'y vois un défi et une opportunité pour le NIMD. Nous devons accroître notre soutien à la croissance des partis politiques "réactifs", qui peuvent mener leur peuple vers un développement durable. Que ce soit en facilitant le dialogue, en fournissant des ressources aux électeurs ou en soutenant les droits politiques des groupes minoritaires, la NIMD peut aider à réaliser les aspirations d'un avenir transparent, inclusif et démocratique à l'ère de l'information.