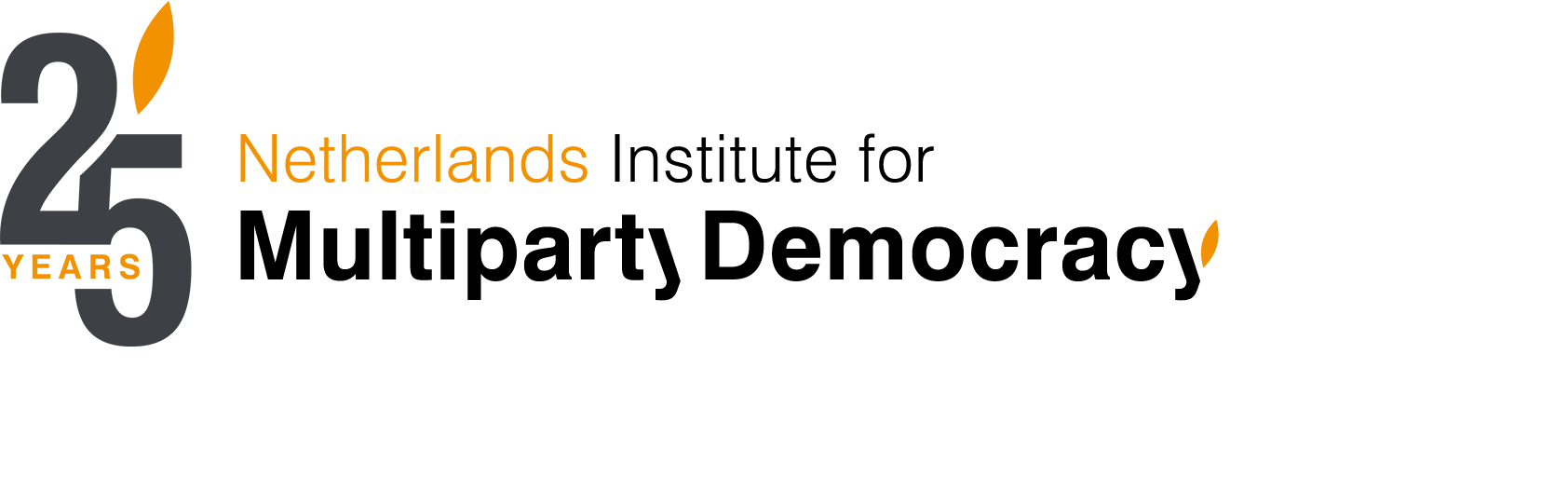INVESTIR DANS LA DÉMOCRATIE AU QUOTIDIEN

Dalila Brosto, conseillère en connaissances du NIMD
La démocratie est en état de malaise. C'est du moins ce qui semble ressortir d'un récent rapport de la Commission européenne. étude réalisée par le nouveau Centre pour l'avenir de la démocratie de l'Université de Cambridgeoù 57,5 % des personnes interrogées se sont déclarées insatisfaites de la démocratie.
Près de 60% des personnes interrogées dans 154 pays ont exprimé leur insatisfaction générale à l'égard de la démocratie dans leur propre pays, soit le niveau le plus élevé depuis près d'un quart de siècle. Les plus hauts niveaux d'insatisfaction ont été enregistrés dans les grandes démocraties telles que l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, tandis que les petites démocraties telles que le Danemark et les Pays-Bas, ainsi que les démocraties asiatiques, ont affiché des niveaux de soutien plus élevés.
Les chercheurs affirment que des événements tels que les chocs économiques et les scandales de corruption peuvent être à l'origine du mécontentement du public. En outre, ils estiment que pour restaurer la confiance dans la démocratie, les institutions démocratiques doivent être en mesure de faire face aux crises majeures de notre époque, des krachs économiques à la menace du réchauffement climatique. Mais la démocratie peut-elle répondre à cette exigence de réussite ? Pourquoi ne pas essayer de contrer les taux d'insatisfaction en investissant dans la démocratie au quotidien, en trouvant des moyens d'engager le débat et de participer au processus vivant qu'est notre démocratie ?

La démocratie : un travail en cours
Une partie du problème réside peut-être dans le fait que nous supposons que les démocraties sont un objectif final, capable de répondre lui-même aux préoccupations des citoyens. La vérité est que la démocratie est un processus sans fin, avec de nouvelles pratiques et expériences qui les aident à s'adapter aux défis qui découlent des changements sociaux, culturels et technologiques.
C'est pourquoi il est si important de réformer constamment et de concevoir de nouveaux modes de participation. Il ne s'agit pas seulement de penser aux cycles électoraux, mais d'amener le débat là où les politiques publiques sont réellement conçues, mises en œuvre et évaluées, c'est-à-dire au niveau de la prise de décision démocratique. Cela signifie qu'il faut aller au-delà de la mobilisation, accroître la participation et donner une voix plus forte aux citoyens en renforçant leur capacité d'engagement dans les affaires publiques.
Se lancer dans l'action locale
Au niveau local, cela pourrait signifier que les communautés peuvent participer non seulement à la conception et à la fourniture des services, mais aussi aux processus décisionnels qui déterminent quels services doivent être fournis, comment et par qui. Par exemple, le budget participatif - un système dans lequel les citoyens s'engagent dans plusieurs séries de débats et de délibérations, et votent finalement sur la manière dont un certain pourcentage du budget municipal est dépensé - a créé un nouveau mécanisme permettant aux citoyens d'exercer leur pouvoir à grande échelle.
Cette innovation démocratique a vu le jour à Porto Alegre, au Brésil, et s'est rapidement répandue dans le monde entier, transformant les relations entre les gouvernements et les administrés. A ParisAvec le budget participatif, les Parisiens disposent d'un budget de 500 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature, ce qui fait de Paris le plus grand budget participatif au monde. L'étape suivante consiste à enrichir le processus en encourageant l'esprit collectif et l'implication des Parisiens, non seulement dans la proposition, mais aussi dans la mise en œuvre des projets. Le fait que de nombreuses collectivités adoptent cette approche est le signe qu'elle fonctionne.

Engager le public ; renforcer la démocratie
Les conseils locaux doivent comprendre que le fait de s'engager auprès de leurs communautés leur permet d'instaurer la confiance d'une manière qui n'est pas possible par le biais de la politique nationale. Les citoyens n'ont pas besoin d'être des experts pour contribuer à un débat constructif ou avoir des idées pertinentes. Leurs opinions, leurs idées et leurs voix devraient faire partie des délibérations, même dans le cas de questions politiques complexes. En voici un exemple, CitizenLab a lancé une plateforme en ligne en 2015 pour donner aux gouvernements une plateforme de participation numérique afin d'inclure leurs citoyens dans la prise de décision. Plus de 100 autorités locales l'ont déployée jusqu'à présent.
D'autres exemples concernent l'utilisation de la technologie pour renforcer l'autonomie des citoyens et leur accès à l'information, les rapprochant ainsi de l'élaboration de la législation. Des organisations telles que Voxe.orgLe NIMD a réalisé des études de cas pour comparer les agendas politiques d'une vingtaine de pays. Partenaire du NIMD au Kenya, MzalendoIl diffuse des informations sur le parlement et les députés à l'intention des électeurs. En stimulant la participation de cette manière, on renforce la confiance du public dans la démocratie, et ouvre la voie à une meilleure élaboration des politiques.
En fin de compte, la démocratie sera toujours insuffisante si nous ne comprenons pas qu'il s'agit d'un processus qui doit être constamment amélioré pour répondre aux défis de l'époque. L'amélioration de la participation contribuera à combler le fossé entre gouvernants et gouvernés, et à placer le public au cœur de la solution. Cela signifie qu'il faut revenir à l'essentiel et trouver des moyens pour que les gens fassent partie du processus démocratique - en bref, investir dans la démocratie au quotidien.