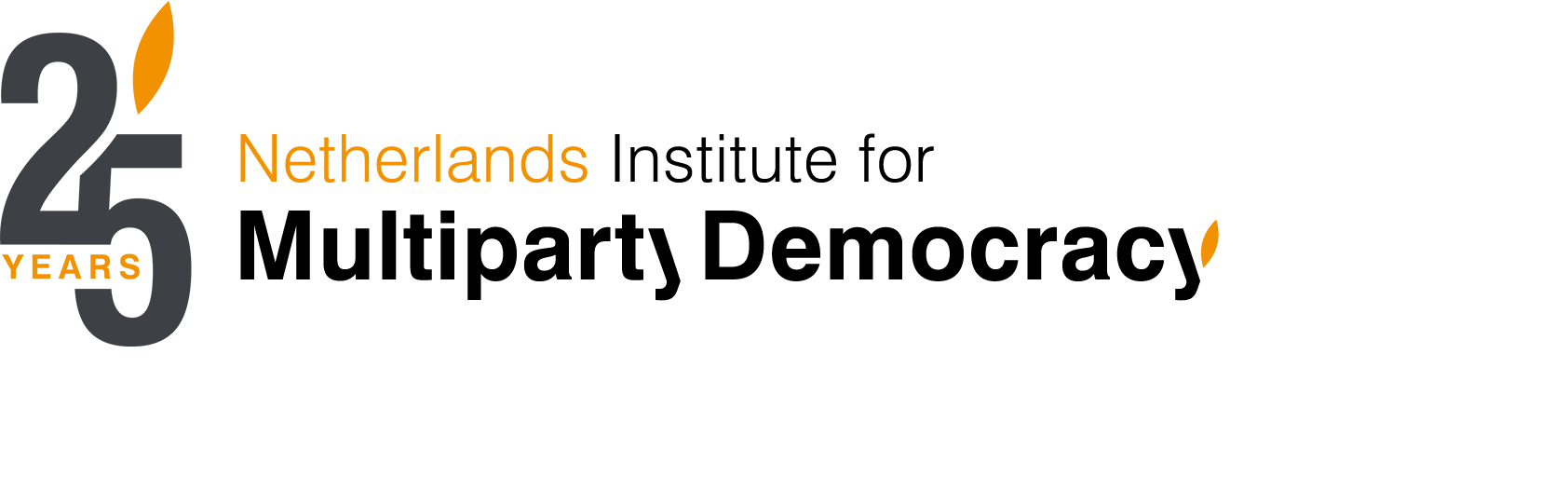La politique de l'identité : un jeu à somme nulle ?

Ce blog est le premier d'une série d'articles dans lesquels Rob van Leeuwen, directeur de programme au NIMD, se penche sur les questions suivantes sur des hypothèses communes concernant la démocratie et le soutien à la démocratie.
L'un des postulats de notre domaine de travail est que les démocraties avancées ont des partis politiques qui sont programmatiques. Cela signifie qu'ils formulent et poursuivent un ensemble cohérent de positions sur les questions de politique publique. Cela devrait les rendre plus responsables devant les électeurs et leur permettre de gouverner plus efficacement lorsqu'ils sont au pouvoir. Dans le cadre de ce modèle, un certain nombre de compromis sont possibles si les projets s'avèrent irréalisables ou si un parti est contraint de collaborer avec d'autres partis ayant des positions différentes.

Ce point de vue reflète l'évolution historique des partis politiques européens depuis le dix-neuvième siècle en tant que véhicules de certaines idéologies. Bien que l'importance de l'idéologie ait rapidement diminué depuis la fin de la guerre froide, nous continuons à définir les partis en fonction de leur position sur l'échiquier politique (gauche ou droite, progressiste ou conservateur) et de leur position à l'égard des principales questions politiques du moment.

Dans le cadre de notre travail au sein du NIMD, les partis programmatiques et les politiques axées sur les problèmes sont opposés aux politiques identitaires, dans lesquelles les partis politiques représentent principalement certains groupes ethniques, religieux ou sectaires. Les politiques identitaires sont problématiques car elles tendent à conduire à des conceptions de la politique fondées sur un jeu à somme nulle, laissant peu de place à la coopération et au compromis. Nous partons du principe que les politiques identitaires sont une caractéristique des démocraties en développement, qu'elles abandonneront lorsqu'elles passeront à un stade plus avancé de la démocratie.
Mais lorsqu'on examine de plus près les partis politiques européens et les personnes qui votent pour eux, on s'aperçoit rapidement que les divisions entre eux sont plus profondes que les divergences d'opinion sur les questions de politique publique. Aux Pays-Bas, par exemple, les partis tendent à se définir principalement par leurs programmes et leurs positions, mais il est facile de constater que certains partis attirent davantage certaines tranches d'âge, des électeurs ruraux ou urbains, plus ou moins instruits.

La plupart des personnes urbaines, cosmopolites et ayant fait des études universitaires qui font partie de mon cercle social actuel sont naturellement enclines à voter pour des partis politiques progressistes ou libéraux. En revanche, les personnes des cercles ruraux et religieux où j'ai grandi sont plus enclines à voter pour des partis conservateurs. De même, j'ai des amis au Royaume-Uni qui sont fermement pro-européens alors que leurs parents sont de fervents partisans du Brexit.
Notre focalisation sur les programmes et les positions des partis cache le fait que sous la surface, il y a un fort courant de politique identitaire. Quelques variables démographiques et socio-économiques suffisent à prédire nos préférences électorales. Nous sommes naturellement enclins à voter pour des hommes politiques qui parlent notre langue, qui font des références culturelles auxquelles nous pouvons nous identifier et qui reflètent nos normes et nos valeurs. Cela signifie que les solutions qu'ils proposent ne sont pas seulement fondées sur des considérations rationnelles, mais aussi sur des identités culturelles.

Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il s'agit d'amener les partis politiques à dialoguer - un processus qui est au cœur de notre travail au NIMD ?

Le dialogue est souvent considéré comme un outil permettant de parvenir à un consensus. Cette volonté de concilier des intérêts différents et de parvenir à un consensus est clairement ancrée dans l'identité néerlandaise de notre organisation (ce que l'on appelle le `modèle de polder'). Mais si l'on examine de plus près l'histoire politique néerlandaise, on constate que les conflits entre les différents groupes identitaires ("piliers") n'ont pas toujours été résolus par consensus. Il s'agissait souvent d'une négociation sur la relation entre l'État et la société et sur la mesure dans laquelle ces groupes étaient autorisés à préserver leur propre identité culturelle. La tension entre le désir de parvenir à un consensus et la nécessité d'accepter les différences subsiste encore aujourd'hui.
Lorsque les identités sont en jeu, le consensus n'est pas toujours possible. Les clivages culturels ne peuvent généralement pas être résolus par un compromis ou une solution technocratique. Le véritable test de la tolérance réside dans notre capacité à accepter des points de vue différents, même s'ils semblent irrationnels ou s'ils vont à l'encontre de nos valeurs et de nos croyances les plus profondes. Cela nécessite un véritable dialogue : un dialogue axé sur la compréhension et le respect mutuel, même lorsque le consensus est hors de portée.