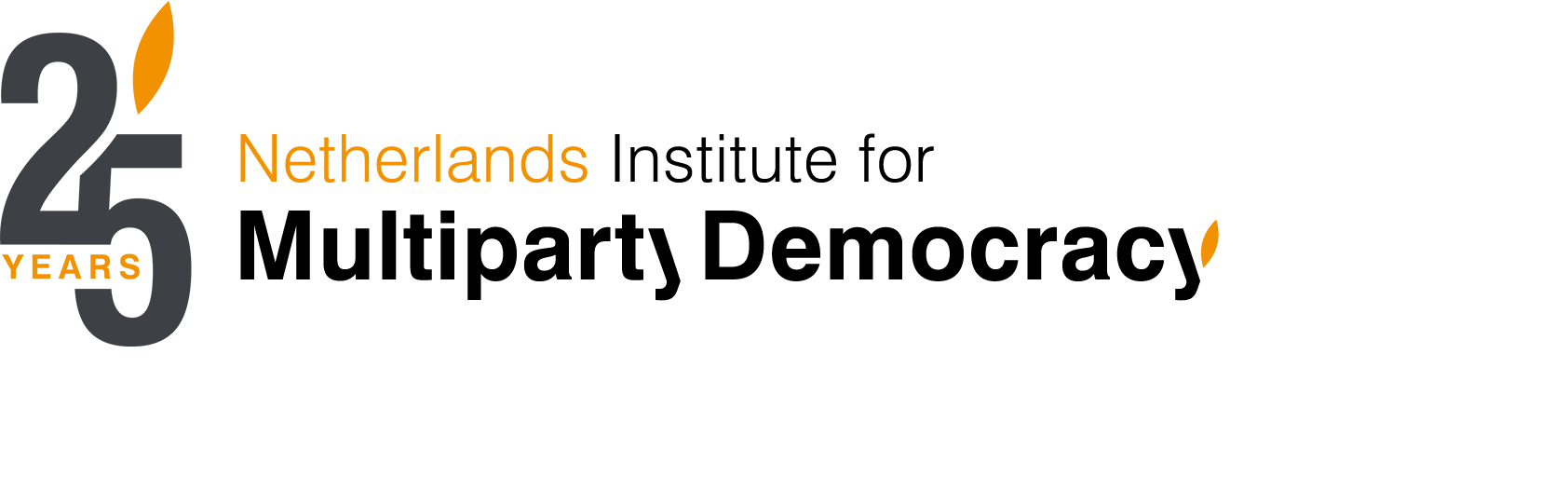Les paradoxes de la politique : Trop de partis ?

Blog de Jerome Scheltens, conseiller en développement des connaissances au NIMD
Ce blog est le deuxième d'une série de réflexions sur Paradoxes politiquesNotre conseiller en développement des connaissances explore la manière dont nous traitons les paradoxes, les contradictions ou les manifestations contre-intuitives de la politique dans le cadre de notre travail.
Y a-t-il jamais trop de partis dans une démocratie ?
La réponse de principe est : "Rien de tel !".
La réalité n'est cependant pas aussi simple.
Si, comme moi, vous êtes un professionnel travaillant dans le domaine du soutien à la démocratie internationale, il y a de fortes chances que l'un de vos pairs vous ait déjà dit, autour d'un verre : "Le paysage des partis politiques dans le pays X est tout simplement incontrôlable ! "Le paysage des partis politiques dans le pays X est tout simplement incontrôlable ! Les citoyens ne peuvent pas faire un choix correct. Il y a tout simplement trop de partis sur le bulletin de vote et ils ne se distinguent pas les uns des autres".
Parties en principe
Je comprends les frustrations de mes collègues et je peux certainement comprendre certains des problèmes qui peuvent découler d'un long bulletin de vote.
Mais avant de sauter sur les contre-mesures, nous devrions revenir sur la raison d'être des partis politiques. Les partis sont des initiatives privées appartenant à des citoyens, créées autour de points de vue et d'intérêts communs.
Après tout, les citoyens peuvent et doivent se rassembler autour de questions d'intérêt public. La création d'un parti politique est un droit politique fondamental, souvent garanti par le droit constitutionnel de réunion. De ce point de vue, il n'y a jamais assez de partis politiques !

Les partis en pratique
Toutefois, dans la pratique, la multiplicité des partis politiques peut poser des problèmes. La raison en est souvent le financement : Dans certains pays, les partis ont immédiatement droit au financement de l'État dès qu'ils s'inscrivent ou se présentent aux élections.
Je me souviens que, juste après sa révolution de 2011 par exemple, la Tunisie a fait cela pour une question de principe. Elle souhaitait apporter un véritable soutien au nouveau droit de réunion de ses citoyens.
D'autres pays, comme le Mozambique par le passé, accordent des financements parce qu'ils y voient un moyen de stimuler la participation publique.
Ces mesures visent réellement à donner une voix à chacun. Mais, malheureusement, elles constituent souvent une incitation à simplement enregistrer un parti sur le papier. Une fois en place, de tels arrangements financiers deviennent contre-productifs et difficilement réversibles, car toute tentative peut être perçue comme une tentative de l'opérateur en place de réduire la concurrence.
Une autre conséquence de ces dispositions financières généreuses est qu'il est très difficile de créer un processus de dialogue efficace entre les partis. Les petits partis, moins organisés, veulent également participer, parfois même immédiatement après s'être inscrits.
Et il est difficile de leur refuser l'accès si l'on prétend s'efforcer d'être inclusif. Il est important que les citoyens et les partis réalisent que l'exercice de leur droit de réunion ne leur donne pas immédiatement le droit de participer à l'administration publique et à la prise de décision.
Seuils de santé
Compte tenu des défis posés par la multiplicité des partis politiques, je pense qu'il est légitime d'introduire des seuils. Ceux-ci doivent bien sûr être raisonnables. Des critères transparents et objectifs sont d'une importance fondamentale, et ils doivent être clairement expliqués et défendus en toute confiance.
Pensez à des mesures pratiques : des procédures d'enregistrement telles que la collecte d'appuis et le paiement de frais de dépôt, qui peuvent amener les partis à se demander s'ils sont suffisamment déterminés à s'engager dans la course électorale et à assumer des responsabilités publiques.
Ces exercices d'équilibre sont au cœur du travail de dialogue interpartis de la NIMD. En règle générale, nous recherchons autant d'inclusivité qu'il est possible de le faire et que nous sommes crédibles. Cela implique l'application d'une série de critères de sélection. Le succès électoral - si ces élections sont libres et équitables, bien sûr - est l'un des critères importants.
La semaine dernière, le NIMD a lancé une nouvelle campagne soulignant la valeur de la démocratie, y compris la nécessité de partis multiples et diversifiés dans une démocratie qui fonctionne. Appréciez et partagez !